Vous a-t-on déjà dit : « Tu es un utopiste ? » Si oui, j’espère seulement que vous n’avez pas rougi, ou baissé les yeux le temps de chercher une ou deux justifications à vos rêves en devenir.
Dans le langage courant actuel, « utopique » signifie impossible. Une utopie serait donc une chimère, une construction purement imaginaire de doux rêveurs dont la réalisation est, a priori, hors de notre portée. Voilà pour le sens quelque peu galvaudé du mot ! Il est essentiel de rappeler que les auteurs à l’origine de cette notion*, avaient pour ambition initiale d’élargir le champ du possible, en commençant par l’explorer.
Alors ne rougissez pas, et relevez la tête, car le monde de demain, il va bien falloir l’inventer !
Certes, l’utopie se caractérise par un recours à la fiction afin de décrire au mieux une société idéale et équilibrée. Mais ce recours à la fiction n’est-il pas aussi nécessaire pour prendre ses distances par rapport au présent ? N’est-il pas indispensable pour mieux le relativiser, afin d’être en mesure de décrire, d’une manière aussi concrète que possible, ce que pourrait être la réalité de demain ? Il m’apparaît qu’il en va de notre responsabilité à tous.
Cependant, pour faire advenir l’utopie, porter un nouveau regard sur soi-même s’impose à chacun d’entre nous. En effet, comment concevoir un changement collectif sans le moindre changement individuel ?
Réaliser l’utopie nécessite d’abord d’opérer en nous de profondes mutations à la fois intimes et psychologiques.
Mais sommes-nous prêts à changer ?
Notre modèle de société est destructeur, et nous le savons. Pourtant certaines barrières psychiques continuent à nous freiner, dès lors qu’il s’agit de franchir le cap du désir au nouveau comportement. Du projet de rêve à la réalité de vie en somme. Alors je m’interroge.
Avons-nous peur qu’advienne le meilleur ?
Y-a-t-il quelque chose en nous qui n’est pas prêt à vivre ce que le dépassement de soi peut engendrer ?
Comment identifier nos zones de blocage afin d’accéder librement à nos zones de talent ?
Nelson Mandela disait « C’est notre lumière, pas notre ombre qui nous effraie le plus. » Or, accepter cette lumière c’est aussi accepter le changement que la réalisation de soi peut générer. C’est accepter de ne plus rester planquer à l’abri, dans l’ombre confortable de nos illusions. C’est accepter d’être transgressif et de s’abandonner à l’inconnu. Seul ce changement de posture – d’abord à l’égard de nous-même, puis à l’égard des autres et du monde – pourra faire apparaître l’utopie.
En outre, nous n’avons plus le choix. N’est-ce-pas invraisemblable de vivre les mutations actuelles sans qu’elles s’accompagnent de cette prise de conscience et d’une véritable évolution intérieure ?
Jack Welch, le dirigeant emblématique américain et ex-patron de General Electric certifie que « Si le degré de changement extérieur surpasse le degré de changement intérieur, la fin est proche. » Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et vulgarisateur du concept de résilience annonçait en avril dernier « Je suis optimiste car on court à la catastrophe. »
Est-il nécessaire de coucher nos sociétés plus longtemps sur le divan d’un futur nauséabond pour en dresser un diagnostic aussi déplorable qu’anxiogène ? Pouvons-nous seulement nous contenter d’être factuel, et de constater que laisser les choses en l’état est pure folie ? Que le déni ou la colère sont des comportements totalement obsolètes car aujourd’hui nous avons les moyens de l’action ?
Allons-nous continuer longtemps à soigner nos gueules de bois avec du mercurochrome ?
Paradoxalement, c’est dans cette période d’inconfort que sommeille peut-être notre chance, car « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve, » nous souffle Edgar Morin. De fait, si nous choisissons d’emprunter ensemble le chemin de la transformation, une seule question s’imposera à nous : Quelles sont les valeurs nécessaires à la réalisation de l’utopie ?
N’est-ce pas plus de cœur, plus de bienveillance et plus d’empathie qui pourraient nous conduire sur les sentiers du salut ? ‘’Naïf’’, argueront probablement les cyniques. Je le conçois, car c’est bel et bien le statu quo qu’ils ont toujours privilégié. Je crois pourtant que ce qui peut encore nous exempter du pire réside dans un génie de sensibilité et d’amour.
Annabelle Baudin
* Les auteurs : Thomas More, historien, théologien et homme politique popularise l’idée « d’utopie,» avec son Utopia (1516), satire du système de gouvernement de son époque. Puis, c’est Rabelais dans son Gargantua (1534), qui conçoit l’abbaye de Thélène, dont la maxime est « Fais ce que voudras.» Platon, Charles Fourier sont cités par André Comte-Sponville dans le dictionnaire philosophique – article Utopie 2001.

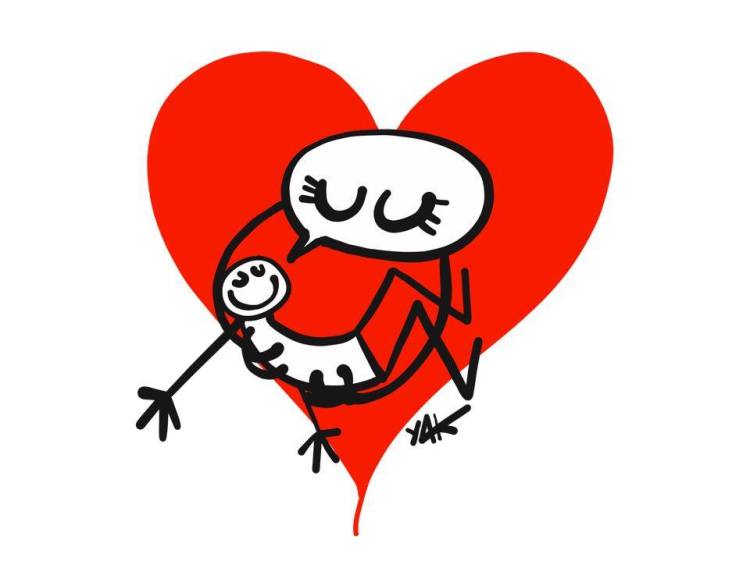
Top !!! Au plaisir de lire ! Je dévore vos articles !!!
J’aimeJ’aime